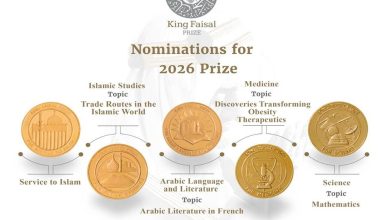L’échange des connaissances entre les peuples selon des normes sociales

Mohammed Tafraouti
La capacité à communiquer efficacement au-delà des frontières culturelles est essentielle à la réussite de toute initiative interculturelle ou multinationale. Elle permet d’améliorer les relations en facilitant les échanges bilatéraux, ce qui favorise à son tour la compréhension mutuelle entre des personnes d’horizons divers et renforce la connaissance des pratiques sociales et des normes culturelles.
L’Afrique est le berceau d’une grande diversité de traditions culturelles, chacune ayant ses spécificités. Ces traditions offrent aux peuples africains un moyen d’exprimer leurs émotions et sentiments de manière mesurée—une approche fondamentale dans les cultures à contexte élevé. Extrêmement variées et riches en expressions symboliques, les traditions africaines sont également profondément cohérentes dans leur logique, au point de donner l’impression d’entrer dans un univers complexe et harmonieux sur le plan esthétique. C’est cet univers que cherchent à redécouvrir les membres de la diaspora africaine.

Les Africains communiquent de multiples façons, souvent en exprimant leurs émotions avec subtilité. La communication est fréquemment indirecte, et il arrive qu’une personne ne comprenne pleinement un message qu’après l’avoir entendu une deuxième ou troisième fois, voire bien plus tard. Ce phénomène est courant, car le sens est souvent implicite plutôt qu’énoncé directement.
Dans de nombreuses sociétés africaines, les symboles ont plus d’importance que les messages littéraux. Ils servent à exprimer et comprendre le monde environnant. Ce lien entre le symbolisme et l’expression se retrouve dans diverses traditions artistiques, telles que la musique, la danse, les arts visuels et le conte. Comprendre ces symboles est essentiel pour saisir la communication africaine, car ils constituent le fondement de la perception de soi et des autres.
Apprendre à décoder les subtilités de la communication est crucial lorsque l’on interagit avec des personnes d’autres cultures. L’empathie, l’adaptabilité et la conscience culturelle sont des éléments clés de la communication interculturelle, qui vise à remplacer l’ambiguïté, le conflit et l’hostilité par la clarté, l’harmonie et la coopération. Il est donc primordial d’être flexible dans notre manière de penser, de réagir et d’interagir avec autrui, ainsi que dans notre manière de parler et d’écouter. Cette approche est essentielle pour favoriser les liens humains, coexister sur Terre et partager ses ressources diversifiées et communes.

Cette vision s’est concrétisée lors de la récente rencontre organisée par le Centre Taousna pour les études et la recherche, en collaboration avec la revue Nabd Al-Mujtama, à l’occasion du Nouvel An amazigh 2975. Cet événement visait à intégrer la diaspora africaine dans le tissu social de la région Souss-Massa, en favorisant l’échange culturel et la compréhension mutuelle.
Le centre a veillé à une participation diversifiée et représentative de plusieurs communautés d’Afrique subsaharienne, notamment du Sénégal, du Niger, du Cameroun, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire, ainsi que de migrants marocains, d’universitaires et d’acteurs de la société civile. La rencontre a permis de créer un environnement chaleureux et interactif, où les participants ont partagé des aspects de leur identité, de leurs traditions et de leurs points communs, en mettant en avant des éléments culturels clés tels que la langue, les arts, les savoirs traditionnels et la spiritualité. Cette diversité a mis en lumière à la fois les similitudes et les différences qui enrichissent le paysage culturel africain.
Le Dr Khalid Alayoud a déclaré que cet événement s’inscrivait dans la vision du centre en tant qu’espace de dialogue interculturel et d’ouverture, en commençant par les cultures africaines avant d’explorer celles d’Europe et d’autres régions du monde. L’un des axes prioritaires du centre est l’étude de la migration sous toutes ses dimensions, un domaine dans lequel Alayoud, en tant que président du centre, est spécialisé.
« Notre célébration du Nouvel An amazigh ne se limite pas à nos familles et à notre communauté. Nous avons voulu inclure les nouveaux arrivants et résidents de la région afin qu’ils découvrent notre culture, goûtent à notre cuisine locale et en perçoivent les spécificités. Nous « partageons le sel » – un acte symbolique qui évoque la confiance, la sécurité et le rejet de la violence et de la trahison. Cela traduit notre engagement envers la coexistence, l’ouverture culturelle et la valorisation de notre identité locale, que nous présentons sans exclusion ni repli sur soi », a-t-il expliqué.
Il a également souligné que « ce que nous faisons au Maroc et dans toute l’Afrique est un éveil culturel qui requiert l’implication des intellectuels et des professionnels de tous horizons. L’Afrique appartient aux Africains, et son avenir doit être façonné par ses propres peuples, y compris les experts disséminés à travers le monde. Ils constituent une formidable ressource humaine qu’il est impératif de mobiliser pour le développement du continent. Située au carrefour du monde et dotée d’une vaste superficie, l’Afrique doit retrouver sa place légitime sur la scène internationale. Ces discussions et initiatives sont des passerelles essentielles pour favoriser le dialogue et bâtir un avenir meilleur pour nous tous. »
L’événement comprenait un repas traditionnel avec du couscous et de la tagoula, préparés avec des saveurs amazighes authentiques et un savoir-faire culinaire ancestral. Une prestation musicale a également eu lieu, interprétée par Moussir, membre fondateur du groupe Lariache, qui a fusionné avec créativité les styles amazigh et africain.
Il convient de souligner que de nombreuses communautés autochtones et minoritaires en Afrique sont victimes de déplacements forcés en raison de conflits politiques, de l’exploitation des ressources naturelles, de grands projets d’infrastructure et du développement touristique. Pour beaucoup, la culture est intimement liée à l’accès à leur terre. Lorsque ce lien est rompu, leur patrimoine culturel est gravement menacé.
Depuis 2013, la politique marocaine en matière de migration et d’asile repose sur des principes humanitaires et sociaux. Le pays a adopté une approche inclusive qui respecte les droits et la dignité des migrants, régularise leur statut juridique et leur accorde des droits économiques et sociaux, facilitant ainsi leur intégration dans la société et le marché du travail.